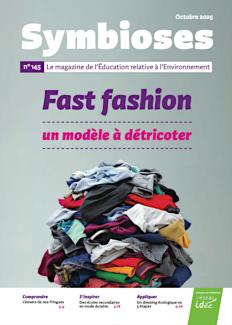Fast fashion : un modèle à détricoter
No limit ?
Vous avez le choix : trois jolies chemises en lin (2 + 1 gratuite), pour un total de 30 euros, dans une enseigne bien connue de la fast fashion ; ou une seule chemise en lin, à l’apparence relativement semblable, à 150 euros, mais tissée en Belgique avec du lin français et vendue dans une boutique éthique. Que décidez-vous ? La majorité des consommateurs et consommatrices opteront pour les vêtements bon marché. A fortiori si leur budget est serré. Même lorsqu’ils ou elles se doutent que lesdites chemises ont été produites dans des conditions de travail déplorables, que leur durée de vie est moindre, que la surconsommation textile de l’Union européenne est la 4e source d’impact sur l’environnement et le changement climatique, et que leur garde-robe déborde de vêtements. Faire une bonne affaire n’aurait pas de prix. Ecouter son envie non plus.
Il en est de même au sein de nos gouvernements. Alors que les restrictions budgétaires guident les discussions ministérielles, une tendance semble se dégager : l’économie drastique réalisée – essentiellement sur les subsides et la fonction publique – l’emporte sur les considérations socio-environnementales. Quand bien même la diminution des aides publiques pour l’environnement menace des centaines d’emplois, la survie des associations et les services essentiels qu’elles rendent à la population (1). Quand bien même, encore, l'inaction climatique coûtera beaucoup plus cher à long terme : une ardoise de 577 millions par an dans un scénario de réchauffement de la planète de 2°C, selon une récente étude de l'Agence wallonne de l'air et du climat. Quand bien même, enfin, un euro investi dans la nature rapporte 8 à 51 fois plus, comme le démontre une étude du VITO et de l’ULiège, exemples belges à l’appui. Le choix – on l’a toujours, même lorsqu’on nous dit « qu’il n’y a pas d’alternatives » – semble davantage dicté par la dépense immédiate évitée que par la préservation de notre environnement, de notre santé, de l’accès à l’éducation, de la cohésion sociale, sur lesquels repose pourtant l’avenir de notre économie.
Ces choix économiques résultent aussi de postures idéologiques. Comme lorsque certains ministres estiment qu’on a été trop vite et trop loin dans les normes climatiques et environnementales, et que cela menace notre compétitivité, ignorant les rapports de tant de scientifiques (2). Lorsque les mêmes (et d’autres) chantent l’éternel refrain de « l’écologie punitive », oubliant au passage que la véritable punition est de voir sa vie détruite par les inondations, la sécheresse ou le feu, comme ce fut encore le cas cet été en Europe et ailleurs. Lorsque, au même moment, les Nations Unies ne parviennent pas à conclure un Traité sur la pollution plastique, par crainte d’un manque à gagner pour les producteurs de pétrole. Ou encore lorsque Trump ose déclarer que le changement climatique est « la plus grande arnaque jamais menée contre le monde ».
Ces discours aux relents de guerre culturelle (3) s’écraseront tôt ou tard contre le mur de la réalité. Qu’on le veuille ou non, nos façons de (sur)produire et (sur)consommer seront un jour ou l’autre contraintes par les limites planétaires, lesquelles ne cessent d’être dépassées (4). « On ne veut plus entendre le “non” que le réel impose à nos désirs », constate le sociologue Gérald Bronner, spécialiste des croyances collectives (5). Selon lui, biberonnés à la pensée magique (wishful thinking en anglais), nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir plier le réel (qui est fini) à nos désirs (infinis). A ne voir que ce que nous croyons (et non l’inverse). A ne plus distinguer le vrai du faux. Une tendance accélérée tant par les discours populistes que par le développement de l'IA.
Le meilleur remède pour sortir de cette ère de la post-vérité, où l’adhésion à un récit prime sur la véracité des faits ? L’éducation, et l’éducation à l’environnement notamment ! Celle qui développe la pensée critique et complexe, qui permet de distinguer faits et opinions, science et idéologie. Celle qui nous reconnecte au réel, nous emmène à la rencontre des autres vivants, humains et non humains, nous rend plus sensible. Celle qui a pour projet une société plus consciente, plus juste, plus durable, plus solidaire, plus inclusive. Celle qui rappelle les limites à ne pas dépasser.
C’est utile pour l’achat d’une chemise comme pour l’orientation des politiques publiques.
Christophe Dubois, Directeur du Réseau IDée
(1) Les associations environnementales tirent la sonnette d’alarme et demandent des budgets à la hauteur des enjeux environnementaux. Voir www.reseau-idee.be/fr/mobilisation
(2) Le ministre Clarinval, dans l’Echo du 26 juillet 2025, ou Alexander De Croo avant lui.
(3) Lire l’intéressante analyse d’Arnaud Zacharie, du CNCD : www.cncd.be/Comment-gagner-la-guerre
(4) En septembre dernier, la 7e limite planétaires (sur 9) a été officiellement dépassée : l’acidification des océans Bon Pote, 2025
(5) A l’assaut du réel - vers la post-réalité, Gérald Bronner, éd. PUF, 2025
Christophe Dubois
Directeur général
Envoyer un mail
0485 94 08 53