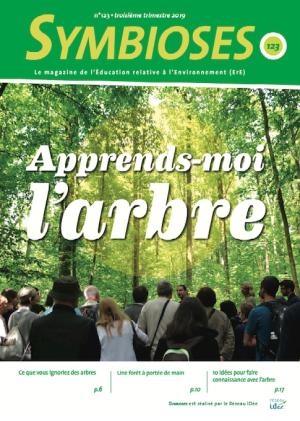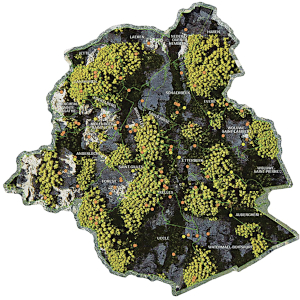Ce que vous ignoriez des arbres
Ce que vous ignoriez des arbres
3è trimestre 2019, un article de Christophe Dubois
Un article du magazine Symbioses n°123 : Apprends-moi l'arbre
Les découvertes scientifiques récentes nous dévoilent progressivement la vie secrète des arbres. Elles fissurent nos représentations et amènent une question essentielle : les arbres ne seraient-ils pas intelligents ?
L’arbre et l’humain, c’est une longue histoire. D’amour et de divorce. Elle a commencé il y a 65 millions d’années. Nous étions des primates et vivions dans les arbres. Nous sommes les héritier·es de cette histoire. Notre corps en porte les stigmates, de nos dents à nos sens, de nos épaules à nos mains, pour voyager de branche en branche (1). Nous en sommes descendu·es, il y a « seulement » 300.000 ans, pour devenir Homo sapiens. Au fil du temps, nous avons quelque peu oublié ces arbres au bord de la route. C’est que nous ne faisions plus partie du même monde. Depuis l’antiquité grecque, et ça continue aujourd’hui, les plantes sont considérées comme représentant un mode de vie inférieur. Francis Hallé, spécialiste des arbres et des forêts tropicales, l’explique fort bien (2) : « Un être humain, ça a une centaine d’organes : cerveau, foie, vessie, yeux, poumons… Chaque organe est responsable d’une fonction. Combien d’organes dans les plantes ? Trois organes : racines, tige, feuilles. Pas la peine de chercher plus, même les fruits sont des feuilles modifiées. Platon et Aristote en ont déduit que, puisque les plantes avaient très peu d’organes, elles n’avaient que très peu de fonctions. Elles ne savent ni marcher, ni parler, c’est donc une forme de vie inférieure sans intérêt. Notre société toute entière nous a mis ça dans la tête. »
Pourtant, bien que différents des êtres humains et dotés de moins d’organes, les arbres n’en ont pas moins de fonctions vitales. « Ils n’ont pas de squelette, ça ne les empêche pas d’être rigides, il suffit de regarder un tronc d’arbre. Ils n’ont pas de poumons, et pourtant ils respirent. Ils n’ont pas de pompes cardiaques, mais dans un arbre, la sève suit un circuit ascendant et descendant. Les plantes n’ont ni queue ni tête, ni bouche ni anus, et pourtant elles digèrent et émettent des excréments », résume le botaniste.
Présents partout
Heureusement, bien que nous nous en soyons éloigné·es, nous ne nous sommes jamais débranché·es complètement de ce monde vert et mystérieux. D’abord, tous nos mythes, nous rappelle Jacques Tassin (1), font référence à l’arbre. L’arbre est sacré, un symbole. Symbole de sagesse, de puissance, de force, de vie, de protection, du temps long… Nos souvenirs aussi s’y accrochent comme à des racines.
En outre, il faut le reconnaître, les forêts nous sont bien utiles : pour absorber le carbone et nous fournir de l’oxygène, réguler l’humidité, dépolluer l’air. Mais aussi pour nous procurer des fruits, nous guérir, composer nos meubles ou nos papiers. En ville, la présence d’arbres permet d’atténuer les effets du réchauffement climatique. Elle diminue même la violence, c’est prouvé scientifiquement. Des sciences qui s’intéressent d’ailleurs de plus en plus à nos voisins végétaux, à leur sensibilité et à leurs facultés extraordinaires. Ces dernières années, nous sommes submergé·es de découvertes scientifiques qui métamorphosent notre regard sur ce monde méconnu. Certain·es parlent même de « l’intelligence des arbres » (3), bien que les mots fabriqués par les humains soient souvent maladroits pour parler des végétaux.
Les arbres communiquent entre eux
Parmi ces découvertes scientifiques, la plus connue est sans doute celle du professeur Van Hoven, de l’Université de Pretoria, sur la communication entre les arbres. En observant les gazelles se nourrissant d’acacias en Afrique du Sud, il constate que l’animal ne s’alimente qu’une petite minute à un premier arbre, avant d’en changer. Par un rapide processus biochimique, ses feuilles sont devenues impropres à la consommation. Mieux, l’analyse révèle que les acacias situés sous le vent du premier arbre sont également devenus toxiques, avant même que la gazelle ne s’y attaque. Pourquoi ? La plante blessée a émis un message gazeux, de l’éthylène, que les autres arbres pourraient traduire par « attention, il y a une gazelle qui va vous manger ». D’autres arbres utilisent le même type de procédé contre les attaques de chenilles. Ou même contre le feu (2). Les arbres ne se parlent pas, mais ils communiquent.
Les racines pour cerveau
Ils communiquent par les airs, mais aussi par voie souterraine. Par exemple, l’équipe d’Ariel Novoplansky, de l’Université Ben Gourion, a découvert que les plantes soumises à la sécheresse étaient capables d’échanger des signaux de détresse par le biais de leurs racines (4). Ces plantes retiennent même cette expérience de sécheresse pour, à l’avenir, mieux s’adapter en pareille circonstance. Même si elles n’ont pas elles-mêmes vécu ce stress mais en ont juste été averties. Mieux encore, une plante qui a été « prévenue » par sa voisine, mais n’a pas été stressée, peut ensuite utiliser cette information à un autre moment de sa vie et à son tour avertir des voisines inexpérimentées si une sécheresse se produit. « Il s’agit de communication, d’apprentissage et de mémorisation de la part de créatures sans cerveau », s’exclame Ariel Novoplansky.
Les champignons aussi participent à cette communication. Présents dans le sol, ils interagissent avec les racines pour faire transiter de l’eau, du carbone et des minéraux du sol vers les arbres, et entre les arbres. Si un arbre manque d’un élément, les arbres voisins lui en envoient par le biais des filaments des champignons. Plus surprenant, ce réseau racinaire et mycorhizien entremêlé permet également aux arbres de communiquer entre eux, de s’envoyer des alertes. Un véritable internet végétal. Certain·es scientifiques (5) estiment même que ce système racinaire serait le cerveau de la forêt, et aurait des similitudes avec notre système nerveux.
Les arbres sont dotés de sens
Par ailleurs, non seulement les arbres communiquent entre eux - et avec certaines espèces animales - mais ils perçoivent aussi leur environnement (6). Les plantes nous « voient » via des photorécepteurs. Certaines perçoivent les odeurs. Elles réagissent aussi à des pressions mécaniques, ce qui traduit une forme de sens du toucher. « J’ai même vu dans un jardin botanique en Chine tropicale un arbuste dont les feuilles bougent lorsque l’on chante très fort. La plante danse, du moins elle réagit au bruit ! », raconte Francis Hallé. Les arbres sont aussi capables de mouvement et de proprioception (le fait de percevoir la position des différentes parties du corps). Ils sont sensibles aux marées. Des recherches sur une liane ont même démontré qu’elle était douée du sens de l’anticipation (2).
Comment les plantes, avec si peu d’organes, sont-elles capables d’autant de fonctions ? Par la décentralisation, explique Hallé : « Leurs fonctions sont décentralisées dans toutes leurs cellules. Ça leur confère une résilience que les animaux n’ont pas. Vous taillez un arbre, ça repousse. »
Les arbres n’ont ni yeux, ni nez, ni oreilles, mais ils perçoivent leur environnement et communiquent entre eux. Ils n’ont pas de cerveau, mais si l’intelligence est la capacité à apprendre, à garder en mémoire et à s’adapter à des conditions difficiles, alors les arbres sont intelligents.
Se reconnecter et s’inspirer
Voilà passées en revue les découvertes scientifiques parmi les plus surprenantes. Mais pour comprendre l’arbre, faire sa connaissance, les connaissances scientifiques ne sont pas tout. Il reste à les compléter d’une rencontre sensible, sans tomber dans l’ésotérisme. « La science, en survol et distanciée, peine à penser le vivant. Retrouvons le chemin des arbres et du sensible », propose Jacques Tassin (1), en défenseur de l’éducation à l’environnement. Il va plus loin : « Comment tirer parti de ce que l’on sait aujourd’hui de l’arbre, de sa manière d’être au monde et de composer avec l’espace et le temps, pour repenser nos modes de vie ? » En favorisant les interactions, les collaborations, avec cette souplesse, cette capacité d’ajustement, en prenant son temps, en recyclant, dans la sobriété. Mais sans prendre les végétaux en modèle. « Retrouver l’arbre, c’est d’abord retrouver l’altérité », souligne l’écologue. Gare à l’anthropomorphisme, les arbres ne nous ressemblent pas !
Son compatriote Francis Hallé ne dit pas autre chose : « L’être humain est très fier de son gros cerveau et des prouesses technologiques extraordinaires que ce cerveau permet. Par contre, ça ne vous aura pas échappé, nous détruisons notre environnement, alors que les plantes, elles, améliorent le leur. La vraie question que je me pose : est-ce que les plantes ne seraient pas beaucoup plus intelligentes que nous ? »
En chiffres
70.000 espèces d’arbres connues.
43.000 ans, c’est l’âge du plus vieil arbre encore en vie, un clone de Houx royal, en Tasmanie.
Les arbres sont les êtres vivants les plus vieux.
120 mètres de hauteur pour un séquoia. C’est deux fois la hauteur de Notre-Dame de Paris.
Les plus grands être vivants sont des arbres.
Sources
(1) Jacques Tassin, Penser comme un arbre, éd. Odile Jacob, 2018.
(2) Voir la conférence Peut-on parler d'intelligence des plantes ?, ainsi que ses ouvrages Du bon usage des arbres (éd. Acte Sud, 2011) et La vie des arbres (Bayard, 2011)
(3) L’intelligence des arbres, documentaire réalisé par J. Dordel et G. Tölke, 2016.
(4) Comment les plantes communiquent par leur racines, prof. A. Novoplansky, conférence TEDx, 2012.
(5) Notamment Suzanne Simard, Université de Colombie Britannique
(6) Sensibilité et communication des arbres : entre faits scientifiques et gentil conte de fée, M. Fournier (AgroParisTech) et Bruno Moulia (Inra), dans Forêt-entreprise, n°243, déc. 2018.