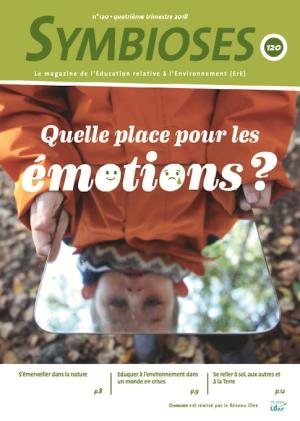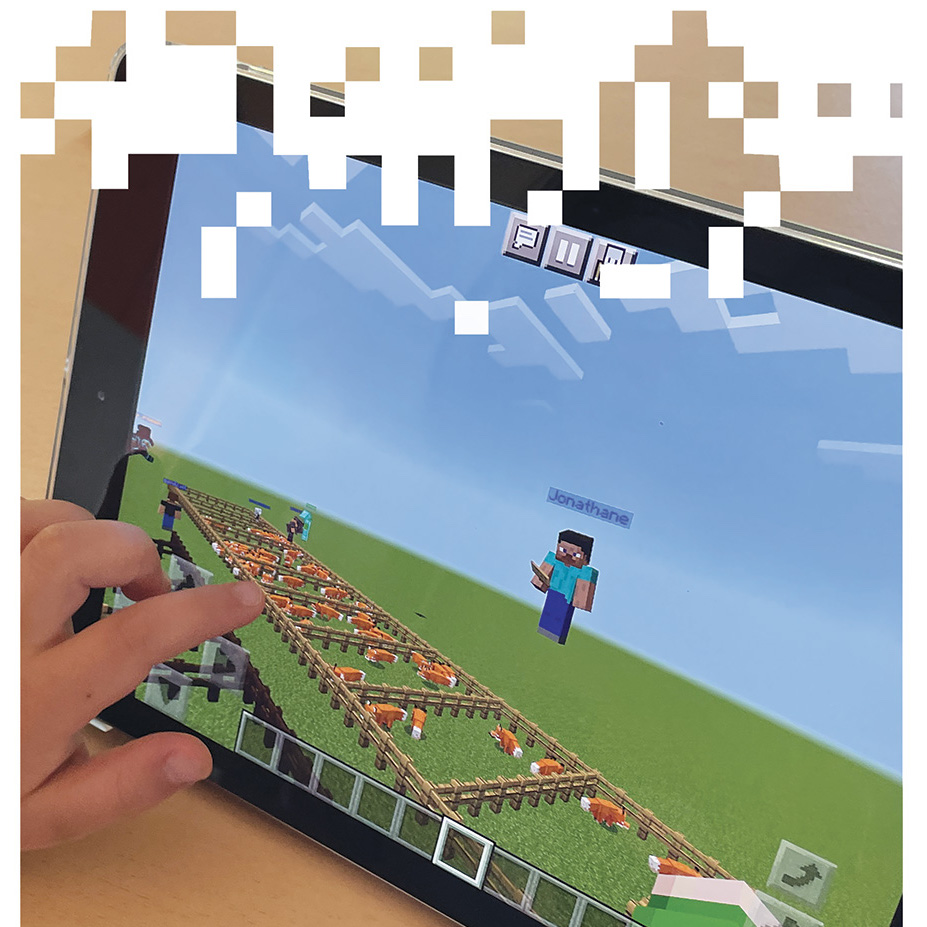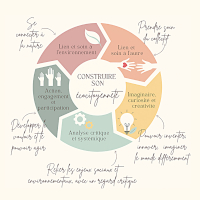Eduquer à l’environnement dans un monde en crises ?
Eduquer à l’environnement dans un monde en crises ?
4è trimestre 2018, un article de Céline Teret
Un article du magazine Symbioses n°120 : Quelle place pour les émotions ?
Crises, catastrophes, effondrement… Les messages alarmistes et alarmants sur l’état du monde portent avec eux leur lot d’émotions et de sentiments diffus. Sur le plan éducatif, comment poursuivre dans l’action face à l’annonce de la « fin d’un monde » ? Partage d’émotions et témoignages d’acteurs et actrices de terrain.
Perte de biodiversité, épuisement des ressources, climat détraqué, inégalités sociales grandissantes… Pas un jour ne se passe sans que les climatologues et scientifiques ne tirent la sonnette d’alarme, à coups de rapports étayés et de conclusions inquiétantes. La société civile s’emballe, elle aussi, quand il s’agit d’aborder l’état du monde actuel et à venir. Un monde à la dérive, en proie à des crises multiples, écologiques, alimentaires, énergétiques, sociales, économiques… Et comme pour encore un peu plus plomber l’ambiance, s’ajoute à ce tableau des morosités : l’inertie politique, le pouvoir du monde économique, la frilosité pour l’engagement citoyen, la montée en puissance des populismes et discours haineux… Tout cela vient inévitablement, à un moment ou l’autre, susciter des émotions et sentiments multiples, oscillant entre colère et peur, dépit et découragement.
Le nouvel effondrement
Récemment, un petit nouveau s’est invité à la table des discours anxiogènes : l’effondrement. Mise en lumière par des chercheurs, l’étude de l’effondrement, autrement appelée collapsologie (de l’anglais « collapse »), annonce « l’idée que notre société, notre civilisation peu à peu se dégrade et meurt » (1). Rien de neuf sous la bruine, si ce n’est une interconnexion de toute une série de crises et le rappel cinglant de l’urgence. D’autant que cet effondrement, systémique et global, déjà annoncé en 1972 dans le rapport scientifique « Halte à la croissance ? » (2), aurait déjà commencé… Aucun retour en arrière possible. Là encore, pas de quoi remonter le moral des troupes.
L’une des critiques faite à l’effondrement : il suscite angoisses et peurs, avec pour effets pervers potentiels l’immobilisme, le repli sur soi, le rejet de l’autre… « Il faut faire attention à ne pas se laisser paralyser par ces annonces d’une fin du monde proche. Car l’une des stratégies pour y répondre pourrait être de jouir de ce dont on peut encore jouir pendant quelques années et qu’après nous, ça sera le déluge », souligne le climatologue Jean-Pascal Van Ypersele.
Pour Pablo Servigne, l’une des figures de proue de l’effondrement, l’idée est plutôt de garder les yeux ouverts sur les catastrophes : « Je veux que ceux qui sont sensibles à ces questions continuent à penser les mauvaises nouvelles. Je suis assez irrité par l’écologie gentille où on s’habille de toutes les couleurs en s’obligeant à être tout le temps positif pour aller vers l’action. L’écologie « bisounours » est dans le déni. A l’inverse, si on n’est que dans le négatif, on développe des ulcères, des dépressions nerveuses… Il faut un juste mélange, avoir toujours un contact avec les égouts et arriver à voir du positif dedans. » (3) Et le collapsologue de souligner encore : « C’est en plongeant dans les ombres, dans les sentiments, dans les émotions dites négatives, comme la tristesse ou la colère, qu’on peut arriver à déclencher une spirale positive. » (4)
Cultiver l’émerveillement
De toute évidence, sur le plan éducatif, un discours de type effondrement ravive le grand débat autour de la pédagogie des catastrophes. En situation d’animation, de formation ou tout autre contexte éducatif, un déferlement d’émotions difficiles peut surgir dès lors que des sujets aussi sensibles que le climat, la dégradation de l’environnement ou l’état du monde figurent au programme ou surviennent de manière inattendue. Evidemment, tout dépendra du type d’activité et de l’objectif poursuivi, du contexte et du public.
Quand bien même, sur le terrain éducatif, la pédagogie des catastrophes et le recours à la peur pour sensibiliser à l’urgence environnementale interpellent. Gabriel de Potter, formateur en éducation à l’environnement, opte pour tout autre chose. « A Education Environnement, nous parions sur une approche positive de l’environnement, rendre celui-ci “aimable”, passionnant, riche, complexe, plein de beautés cachées, de défis, d’acteurs de changement, d’alternatives déjà en place. C’est dans ce terreau, cet enracinement, que les personnes trouveront les deux mots indispensables : plaisir et désir, à leur échelle. Il faut insuffler une pulsion de vie, pas de mort, même si un jour le ciel devait quand même nous tomber sur la tête… Il faut être éducateur et militant, mais pas en même temps. Ma vie professionnelle, c’est d’être éducateur, mes choix privés sont de soutenir des ONG et groupes de pression. »
Zita Csany est animatrice à Nature Attitude/CRIE d’Anlier. Si, selon, elle, il est important « d’oser voir le côté sombre de notre société et l’état de la planète », elle dit craindre « l’effet néfaste de se laisser envahir par la peur et le sentiment de désastre ». Lorsqu’elle accompagne un groupe, elle préfère d’ailleurs « cultiver l’émerveillement et mettre l’accent sur le plaisir, sans pour autant cacher la réalité. »
Le devoir de s’en saisir
Pour Sébastien Kennes, formateur à Rencontre des Continents, association à la croisée de différentes « éducation à », il faut se saisir d’une question telle que l’effondrement « pour ne pas la laisser dans le seul giron des discours fascisants surfant sur la peur », qui justifieraient le repli sur soi et les régimes autoritaires. Afin de mieux cerner ce concept émergeant, Rencontres des Continents et d’autres associations ont organisé une formation sur la collapsologie destinée aux personnes relais actives en éducation populaire (5). Histoire de tâter le terrain, d’examiner ce que le secteur pourrait en faire. La perspective d’un système économique et sociétal qui pourrait s’écrouler à moyen terme interroge en effet le cœur des organisations, leur finalité, leur fonctionnement. « En tant qu’association d’éducation, on se doit de travailler cette question parce qu’elle est là, elle est présente, poursuit Sébastien Kennes. Ca ne veut pas dire qu’on considère la collapsologie comme une vérité, mais plutôt comme un constat. On devrait tous être capables de parler collectivement d’effondrement, car tout le monde le vit à des niveaux différents et cela suscite beaucoup d’émotions. Chez nous, en interne, on en est encore au stade de la recherche. C’est bien loin d’avoir contaminé nos pratiques, nos postures ou nos messages éducatifs. »
Du côté de l’asbl Empreintes/CRIE de Namur aussi, on s’est emparé de cette notion. Pour mieux comprendre, pour mieux se positionner. Un travail qui bouscule, comme l’exprime Julie Allard, responsable du département animation : « Dans un premier temps, tu remets un peu tout en question, tu t’interroges sur l’utilité de ce que tu fais, sur l’impact que ça a réellement… Puis, tu digères et tu te rends compte que, oui, c’est utile d’outiller les gens qu’on croise lors de nos animations. » L’effondrement s’affiche désormais dans la charte associative de cette organisation de jeunesse active dans l’éducation à l’environnement. Mais jusqu’à présent, aucune sensibilisation à ce sujet vers l’extérieur. « Lors de nos animations avec les jeunes, on ne formule pas l’urgence. Tout dépend évidemment de l’activité qu’on va proposer et de l’objectif qu’on poursuit, mais si certains sujets suscitent des émotions négatives, on va les accueillir et enchaîner ensuite sur du positif : les alternatives possibles, les moyens d’agir… »
Colère et plaisir
« Je ne suis pas un éternel optimiste. Dans mes formations, je ne prétends pas qu’on va tout résoudre et que l’avenir sera juste, durable et soutenable. Je dis que oui, c’est une possibilité que tout s’effondre, on n’en sait rien. » Amaury Ghijselings est formateur chez Greenpeace Belgique et au sein du collectif La Volte. Il est aussi activiste. Et à ce titre, il partage : « Je suis gagné par les émotions mais jamais par le découragement. Moi, ce que j’ai, c’est de la colère. Elle explose quand il y a de grands moments d’immobilisme. Et je la canalise en actions collectives. »
La colère, Marie De Vroey, formatrice au sein de Quinoa, ONG d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, la côtoie également : « Tous les processus d’éducation populaire travaillent à partir d’injustices vécues ou perçues. L’effondrement fait beaucoup parler de lui pour l’instant, mais les injustices existent depuis des décennies… Elles créent un sentiment d’impuissance et des émotions, comme la colère. Et la colère, c’est un super levier d’action ! Moi, je suis aussi en colère, indignée, révoltée, et je m’engage de différentes manières. C’est ça aussi que j’ai envie de partager au cours de mes formations. Ce qui me fait bouger, ce qui m’inspire... Il n’y a pas de bonne manière de s’engager, de mode d’emploi idéal. Et on ne va pas changer le monde, le système est bien trop complexe pour cela. Mais ne rien faire c’est renforcer le système. »
« Le moteur de l’engagement, c’est ici et maintenant, poursuit Amaury Ghijselings. On ne s’engage pas pour la justice et l’écologie de demain, mais d’aujourd’hui. Et on ne s’engage pas non plus pour se sacrifier. Quand on dit engagez-vous, on dit : épanouissez-vous, libérez-vous, amusez-vous, écoutez vos valeurs ! Une fois de plus, on ne sait pas si on va régler les problèmes de climat ou de biodiversité, mais au moins, on prend du plaisir. Et ça, c’est un tabou qu’on doit libérer. Si, en tant qu’éducateurs, animateurs, on veut que les gens s’engagent alors que le monde est en train de s’écrouler autour de nous, on doit pouvoir aussi leur dire de trouver une forme d’épanouissement dans leur engagement. »
Et Sébastien Kennes de conclure sur une note positive : « Il y a plein de gens qui bougent, d’initiatives citoyennes qui se mettent en place, d’alternatives qui voient le jour. Ça semble trop anecdotique par rapport à la masse dominante, mais il y a plein d’endroits où il y a de quoi se réjouir. »
(1) Issu de l’interview de Pablo Servigne sur https://positivr.fr Pour en savoir plus, lire son ouvrage coécrit avec Raphaël Stevens : « Comment tout peut s'effondrer »
(2) Lire sa réédition: « Les Limites à la croissance (dans un monde fini) : Le rapport Meadows, 30 ans après », D. et D. Meadows, J. Randers, Ed. Rue de l'échiquier, 2012
(3) Interview de Pablo Servigne : « Les plus individualistes crèveront les premiers », 19/02/2016.
(4) Dans l’article « Collapsologie : passer de la prise de conscience à la prise en compte de la réalité », Oxfam, 13/09/2018.
(5) Formation proposée début 2018 par Rencontres des Continents, Quinoa et Mycellium.