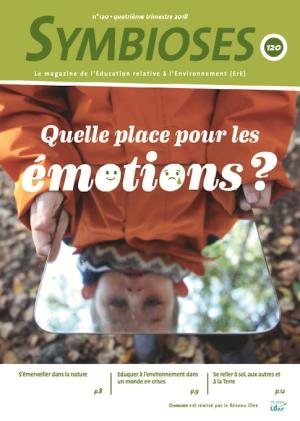S’émerveiller dans la nature
S’émerveiller dans la nature
4è trimestre 2018, propos recueillis par Céline Teret
Un article du magazine Symbioses n°120 : Quelle place pour les émotions ?
Formateur à Education Environnement, Gabriel de Potter invite à (re)découvrir l’approche sensible de la nature. Une pédagogie « enchanteresse » au creux de laquelle se nichent les émotions. Interview d’un facilitateur d’émerveillement.
Photo ©François Beckers
L'éducation à l’environnement a souvent recours aux approches dites sensorielles et sensibles. L'une n'est pas l'autre. Où se situent les émotions dans ces approches ?
L’approche sensorielle consiste à mettre en place des activités qui sollicitent les cinq sens des participants : vue, odorat, ouïe, toucher, goût. On est donc clairement dans le registre des sensations, pas forcément des émotions, mais c’est une entrée royale pour leur irruption. L’approche sensible est celle qui s’adresse à notre sensibilité.
Les émotions surgissent quand nous avons été touchés dans notre sensibilité, c’est-à-dire dans notre capacité de sentir, ressentir, s’émouvoir, aimer, détester, vibrer dans un sens ou un autre. Je préfère parler d’approche sensible que d’approche émotionnelle, parce qu’elle intègre plus la notion de finesse et de temps. Finesse de ressentis, finesse de sentiments et, je l’espère, plus tard, finesse dans la réflexion et le jugement. Pas que l’immédiateté donc. Une sensibilisation à l’environnement par le cœur et non par la tête, dit-on souvent. Mais le cœur agit sur la tête ! Une fois notre sensibilité touchée, tout le reste peut s’enclencher : l’empathie, une réflexion morale, un changement dans les comportements, dans les valeurs.
En tant que formateur, comment accompagnes-tu les émotions des participant·e·s ?
Je ne demande qu’une chose, c’est d’être le délencheur et le facilitateur d’émotions positives. C’est surtout une question d’attitude et de comportement. Cela m’a pris du temps, par exemple, d’oser demander, voire d’exiger le silence lors d’une balade nature. L’idée est de se décaler de la balade explicative et basée sur l’approche cognitive. Changer une seule variable (la parole) peut rapidement faire basculer le groupe vers plus de ressenti, d’émerveillement… C’est immédiat pour certain·e·s, pour d’autres, il faut les aider par une série de petites suggestions. Cela perturbe parfois car notre culture et notre éducation privilégient le plus souvent la dimension rationnelle dans l’observation et la compréhension des choses. Mais souvent, les participant·e·s sont ravi·e·s de retrouver ce contact sensible dans la nature.
Et vous en parlez, de ces émotions ressenties ?
De manière générale, c’est après le moment vécu, parfois lors du feed-back. Mais le plus souvent, c’est longtemps après que des personnes me disent que tel ou tel moment les a marquées profondément.
Le but n’est pas de susciter des émotions chocs, qui s’expriment en direct. Il s’agit plutôt d’installer quelques activités qui vont emmener le groupe vers une perception plus fine du lieu ou du thème, par petites touches successives. C’est d’ailleurs dans l’ADN de toute l’équipe d’Education Environnement : participer modestement à une approche ré-enchanteresse de la nature pour donner libre accès aux émotions positives.
Lors d’un stage récent, nous avons reçu des témoignages de participants qui résument bien ce que nous tentons de faire : « La découverte de soi, de certaines choses enfouies et qui font remonter les sensations que l'on avait quand on était enfant et que l'on a laissé sur le bord du chemin », « une connexion avec la nature qui engendre une sensation de paix, de calme et de plénitude ».
Les émotions, c’est à la mode. Le secteur environnemental aussi se les approprie d’une certaine manière, par exemple en les utilisant pour toucher son public. Comment vous situez-vous, chez Education Environnement, par rapport à cela ?
Montrer une vidéo avec un porc qui agonise dans un abattoir, c’est clairement le choix d’utiliser les émotions désagréables pour aborder une réalité problématique.
Mais quand, au milieu d’un bois, un animateur invite les enfants à s’installer dans son « petit milieu personnel » ou invite son public à se taire en forêt, il n’utilise pas les émotions. Il met en place des situations favorables à leur émergence, c’est tout. Et en plus, il ignore laquelle surgira, chez qui et quand. Bien sûr, l’animateur aura ensuite un devoir d’accompagnement. C’est un autre choix que d’être un distributeur d’émotion.
L’approche émotionnelle peut donc se pratiquer avec une vision bien précise sur le but à atteindre (déclencher une émotion dans le groupe) ou, au contraire, se concevoir de telle manière que, plongée dans telle ou telle situation par l’animateur ou l’animatrice, chaque personne s’appropriera elle-même des émotions inédites ou oubliées.